|
On ne peut pas être responsable de ce que l’on ne décide pas
Le 17/10/25
« On ne peut pas être responsable de ce que l’on ne décide pas. »
Voilà une évidence trop souvent oubliée. En effet, la responsabilisation sans décision est une illusion. Comment éviter ce piège ? Dans de nombreuses organisations, on demande aux collaborateurs d’être responsables, engagés, acteurs du changement… mais sans jamais leur donner un véritable pouvoir de décision. Or, sans autonomie décisionnelle, la responsabilisation reste une façade : on ne peut pas être responsable de ce que l’on ne choisit pas.
La responsabilité implique pourtant une marge de manœuvre : on attend de quelqu’un qu’il réponde de ses actes quand il a pu en choisir les modalités (au moins en partie). Si le manager prescrit chaque pas, le collaborateur devient un simple exécutant ; il agit sous contrainte, mais sans responsabilité réelle.
Dans la théorie des organisations, Herbert Simon, dès les années 1940, rappelait que « decision-making is the heart of administration ». L’autonomie décisionnelle est au cœur de la performance : elle stimule la motivation, la fierté et le sentiment de compétence.
Mais alors, comment créer les conditions d’une autonomie décisionnelle réelle ? Comment lever les freins et accompagner concrètement cette évolution vers une culture de responsabilisation ?
Au programme de cet article :
- L’autonomie décisionnelle, fondement de la responsabilisation.
- Quand on co-décide, on co-assume. Lorsque la décision est collective, la responsabilité le devient aussi.
- Pourquoi les managers résistent encore ?
- Développer une autonomie encadrée.
- De l’intention à l’action : comment accompagner l’autonomie décisionnelle ?
- 4 points essentiels à retenir pour développer l’autonomie décisionnelle.
L’autonomie décisionnelle, fondement de la responsabilisation

Campbell (2011) examine les Decision-Making Empowerment (DME) et montre que plus un collaborateur dispose d’autonomie dans les décisions, plus les attributions internes (comme la fierté ou le sens) tendent vers la responsabilisation.
De manière plus contemporaine, dans le champ du leadership et de l’empowerment, Ye et al. (2022) montrent que les comportements de leadership qui favorisent la participation dans la décision (participative decision making) sont positivement liés à l’engagement, au sentiment de compétence et à la responsabilisation des collaborateurs.
Quand un collaborateur contribue à la définition du « comment », il s’approprie aussi le « pourquoi ». À l’inverse, quand tout est décidé ailleurs, la responsabilisation devient une illusion : comment répondre d’un résultat si l’on n’a pas choisi la voie ?
Un revers mérite d’être noté : déléguer une décision peut aussi être perçu comme un fardeau. Blunden & Steffel (2024) rappellent que certains employés considèrent la responsabilité décisionnelle comme une charge, surtout s’ils manquent de soutien ou de cadre clair.
Quand on co-décide, on co-assume. Lorsque la décision est collective, la responsabilité le devient aussi
La décision collective est un levier puissant de cohésion et d’intelligence collective. Elle mobilise la diversité des points de vue, renforce l’adhésion et favorise la qualité des choix.
Mais elle a aussi ses pièges : diffusion de responsabilité, recherche infinie du consensus, ou domination des plus forts.
Les modèles de Vroom et Yetton rappellent qu’il existe plusieurs niveaux de participation à la décision : autocratique, consultatif, participatif, ou délégatif. Le bon manager ajuste son approche selon la complexité, l’urgence et les compétences de son équipe.
Un exemple souvent cité dans la littérature managériale est celui de la firme Haier (groupe chinois d’électroménager) qui a mis en place un système de « micro-entreprises » autonomes : chaque unité dispose d’une large autonomie décisionnelle (sur les ressources, le prix, l’innovation), avec une forte responsabilisation locale. Cette organisation avec « beaucoup de petites unités décisionnelles » permet une grande proximité avec le marché et responsabilise fortement les collaborateurs.
*Lire aussi : “Le management du changement : la magie de la co-élaboration”.
Pourquoi les managers résistent encore ?
Beaucoup de managers savent que développer l’autonomie décisionnelle est vertueux, mais résistent à le faire dans les faits. Les freins sont multiples :
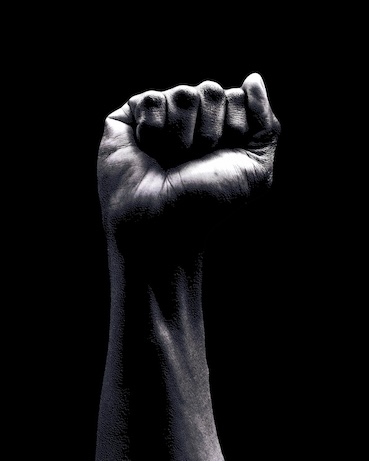
- La peur de perdre le contrôle : déléguer peut donner le sentiment de se dessaisir de son autorité.
- La crainte de l’erreur : « Et si le collaborateur se trompe ? »
- Le manque de confiance dans les compétences des collaborateurs : penser que les collaborateurs ne sont pas assez compétents pour décider.
- Responsabilité ultime incompressible : le manager reste « dernier garant » aux yeux de la hiérarchie, ce qui limite sa propension à déléguer.
- Les habitudes culturelles : dans des environnements hiérarchiques ou institutionnels, la centralisation du pouvoir reste la norme implicite et déléguer des décisions peut être vécu comme un « lâcher-prise » dangereux.
La recherche confirme ces freins. Maas et al. (2023) ont montré que la peur du blâme est l’un des obstacles majeurs à la délégation managériale effective : les managers préfèrent assumer seuls une mauvaise décision que d’être tenus pour responsables d’un échec « délégué ».
Et comme le souligne l’article « Why aren’t I better at delegating ? » (Harvard Business Review, 2025), « le vrai piège du management, c’est de croire qu’on garde la maîtrise en décidant seul. ». Or, en voulant tout contrôler et décider seul, le manager finit souvent par étouffer l’initiative et ralentir la réactivité collective. À l’inverse, la confiance accordée dans la prise de décision devient un formidable catalyseur d’énergie.
Développer une autonomie encadrée
Attention aussi à la croyance limitante : déléguer une décision ne signifie pas renoncer à son rôle de manager. Cela veut dire simplement organiser les conditions d’un choix éclairé.
C’est ce qu’on appelle une autonomie encadrée : un espace où le collaborateur agit librement, mais dans un périmètre partagé et « sécurisé ».
Quelques repères :
- Définir un cadre clair (objectifs, contraintes, critères de réussite),
- Partager les informations utiles,
- Accompagner le raisonnement,
- Valoriser la décision, même imparfaite, quand elle est cohérente avec le cadre.
*Lire aussi : “Des collaborateurs en soif de liberté dans les entreprises”.
De l’intention à l’action : comment accompagner l’autonomie décisionnelle ?
La responsabilisation décisionnelle ne s’improvise pas. Cela s’apprend, s’expérimente et se structure.

Voici quelques leviers concrets :
- Cartographier les décisions : distinguer celles qui doivent rester managériales (enjeux stratégiques, légaux) et celles qui peuvent être confiées à l’équipe.
- Définir les critères de délégation : importance, risque, maturité du collaborateur, impact sur la performance.
- Lancer des pilotes : commencer petit, sur des sujets concrets à faible risque, pour instaurer la confiance.
- Former à la prise de décision : apprendre à raisonner avec discernement, à évaluer des scénarios, les risques et conséquences, à argumenter.
- Créer un rituel de retour d’expérience : après chaque décision déléguée, analyser ensemble ce qui a bien ou mal fonctionné.
- Valoriser le raisonnement plutôt que le résultat : juger la qualité du processus, non l’issue. C’est ce que les chercheurs Gillenkirch & Velthuis (2023) appellent « éviter le biais du résultat ».
- Aligner la reconnaissance et l’évaluation : récompenser la prise d’initiative et la qualité du jugement, pas seulement les succès visibles.
- Accompagner les managers dans leur propre transformation : passer du rôle de « décideur unique » à celui de facilitateur de décisions.
Ce glissement de posture est exigeant, mais libérateur. Il transforme le rôle du manager : d’un contrôleur de tâches, il devient un architecte de la responsabilité.
Donner le pouvoir de décision à ses collaborateurs n’est pas une perte d’autorité ; c’est un investissement dans l’intelligence collective. Il ne relève pas d’un élan généreux ou d’une mode managériale : c’est une condition nécessaire de la responsabilisation authentique.
Car on ne devient pas responsable parce qu’on nous le demande, on le devient parce qu’on nous en donne le droit.
4 points essentiels à retenir pour développer l’autonomie décisionnelle
- La responsabilité réelle requiert une marge de décision : une obligation sans choix est une illusion de responsabilité.
- La décision (individuelle ou collective) est un levier puissant de motivation, de fierté et d’engagement, mais mal structurée, elle peut déstabiliser.
- Les managers résistent souvent à déléguer les décisions par crainte du contrôle perdu, des erreurs ou des jugements, mais ces résistances peuvent être travaillées et dépassées.
- Le chemin vers une culture de responsabilisation passe par une progression pas à pas, des balises claires, du soutien et un changement de posture managériale.
Pour aller plus loi, téléchargez notre livre blanc sur la responsabilisation des équipes :
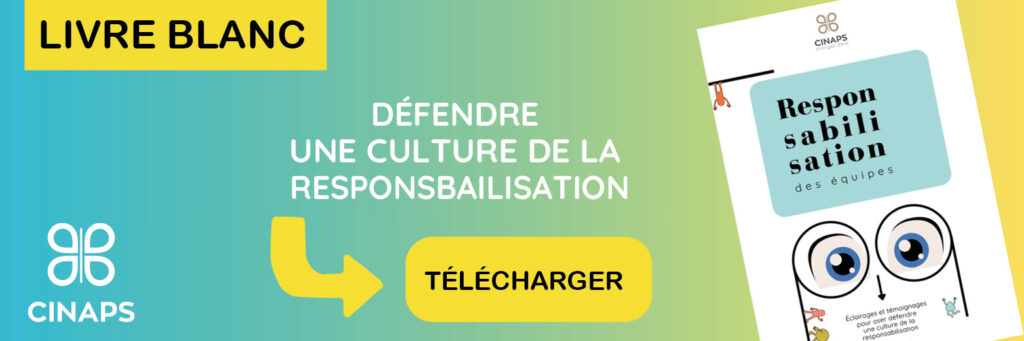

Damien Gauthier – Directeur associé et consultant.
Enfin, pour continuer à rester en contact…



