|
Tensions relationnelles au travail : quand ça ne pète pas… mais que ça casse
Le 11/07/25
Dans le monde du travail, certaines tensions relationnelles ne claquent pas comme une porte qu’on claque en criant. Elles s’infiltrent. Elles grignotent. Elles ne se disent pas, mais elles se vivent. Il n’y a pas d’éclat de voix, pas de conflit ouvert. Juste… une fatigue. Une démotivation. Une envie qui s’efface. Une collaboration qui s’éteint. Ce sont des tensions relationnelles souterraines.
Il y a des tensions qui explosent. Et d’autres qui s’installent en silence
En tant qu’accompagnant, je rencontre régulièrement des équipes où le lien s’est distendu sans fracas. Pas de cris, pas de conflit ouvert, rien de spectaculaire. Juste une forme d’usure, de fatigue, un désengagement diffus. Une envie de travailler ensemble qui s’efface peu à peu, sans bruit. On continue à se parler, mais à distance. On coopère, mais à minima. On se tolère, mais on ne s’écoute plus vraiment.
Ce sont des situations d’autant plus complexes qu’elles échappent aux grilles classiques du “conflit” : rien de vraiment visible, rien de directement verbalisé. Pourtant, la relation, qu’elle soit individuelle ou collective, est abîmée. Et si on n’y prend pas garde, cette ambiance grise devient la norme. Une relation qui “fonctionne”, mais qui n’est plus vivante.
Une dynamique de retrait masqué
Ce type de tensions relationnelles au travail est difficile à nommer, parce qu’elles ne se manifestent pas frontalement. Elles ne prennent pas la forme d’un débat houleux ou d’un affrontement ouvert. Elles s’installent lentement, par petits gestes, par petits renoncements. C’est une dynamique d’usure. On commence à ne plus consulter tel collègue, parce qu’on n’attend plus rien de ses réactions. On cesse de faire l’effort de comprendre les intentions des autres. On passe en mode « automatique », en se protégeant.
Et surtout, on se résigne… On ne veut pas aggraver les choses… On se dit que ce n’est pas si grave. On trouve des routines qui permettent d’éviter les frictions. Et, sans s’en rendre compte, on transforme la relation en juxtaposition de solitudes.
L’art d’accompagner les tensions relationnelles silencieuses
Dans la plupart des formations en management ou en communication, on apprend à gérer les conflits. On y parle de communication non-violente, de feedback, de gestion des émotions, de clarification des attentes, de régulation. On y propose des grilles de lecture, des étapes, des protocoles.
Tout cela est utile mais pas suffisant. Cela reste souvent inadapté à une forme de tension bien plus sournoise, bien plus insidieuse : celle qui ne se manifeste pas par des cris, mais par une lente extinction du lien.
En tant que coach ou médiateur, il nous arrive d’entrer dans des équipes où la situation ne semble pas particulièrement tendue. Pas de colère exprimée. Pas d’explosion. Pas de conflit en apparence. Et pourtant, quelque chose ne circule plus. Les regards se fuient. Les conversations sont réduites au strict nécessaire. L’enthousiasme est absent. Les initiatives sont rares. Et surtout, l’envie de collaborer semble s’être dissoute :
- Ce n’est pas un désaccord, c’est un retrait.
- Ce n’est pas une opposition, c’est une absence.
- Ce n’est pas une guerre, c’est une forme de mort relationnelle.
Tensions relationnelles au travail : le piège du silence
Dans ces contextes, le silence est doublement piégeux. D’abord parce qu’il rend la situation difficile à diagnostiquer : les managers, parfois, n’y voient qu’un “manque de motivation”, une “perte d’énergie”, un “passage à vide”. Et ensuite parce qu’il empêche toute réparation : s’il n’y a rien à dire, comment ouvrir un espace pour le dire ?
Or, cette souffrance relationnelle vécue par les intéressés n’est pas toujours bruyante. Elle peut être muette, contenue, digne. Mais elle n’en est pas moins réelle.
Et souvent, les personnes concernées ont l’impression qu’il est « trop tard », que « ça ne changera rien », qu’il n’y a plus rien à faire.
Mais en réalité, ce n’est pas un mur qu’il faut franchir, c’est un brouillard qu’il faut traverser.
La posture de l’accompagnant : présence et subtilité
Dans ce type de configuration, la qualité de présence de l’accompagnant est primordiale. Ce n’est pas le moment d’imposer un dispositif, de faire parler coûte que coûte, d’agiter des méthodes. Il s’agit d’installer un espace. Un espace de confiance, de lenteur, d’accueil. Un espace où les non-dits peuvent commencer à s’ébaucher, sans se sentir immédiatement exposés, ni jugés.
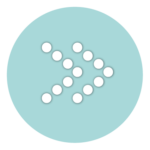
Cela commence souvent par de toutes petites choses :
- Un temps de parole sans interruption.
- Une consigne qui invite à parler de soi, et non des autres.
- Une métaphore qui permet de dire sans désigner.
- Une écoute qui ne cherche pas à résoudre.
Notre rôle n’est pas d’extraire le problème à la pince. C’est de faire suffisamment de place pour que les personnes osent remettre un pied dans la relation. Même timidement. Même maladroitement.
Une réparation par le lien, pas par le contenu
Souvent, les managers veulent « régler » les choses en recentrant les équipes sur le projet, la mission, l’objectif commun. C’est compréhensible. Mais dans ces situations, le problème n’est plus dans le contenu du travail ; il est dans le lien.
Or, quand le lien est blessé, les objectifs ne suffisent plus.
Les personnes n’avancent plus parce qu’il n’y a plus de confiance, plus d’envie, plus de goût. Avant même de vouloir coopérer, il faut que le désir de se retrouver émerge à nouveau. Cela demande de faire un pas de côté. De ne pas chercher la performance immédiatement, mais de rouvrir d’abord l’espace humain.
Cela peut passer par des gestes simples, mais puissants :
- Un moment partagé hors cadre habituel,
- Un souvenir commun mobilisé,
- Une réussite passée racontée,
- Un échange sincère sur ce qui fait obstacle à l’envie.
Ce que nous apprennent ces accompagnements
Ces accompagnements des tensions relationnelles au travail sont parmi les plus exigeants. Il n’y a pas de scénario à suivre. Peu de choses visibles à observer. Aucun déclencheur immédiat. C’est un travail de fond, souvent lent, parfois ingrat, mais infiniment précieux.
Ils nous apprennent que le lien humain est au cœur du fonctionnement des organisations. Que sans lui, tout se fait, mais rien ne se vit. Que les meilleures procédures, les stratégies les plus ambitieuses, les outils les plus performants ne tiendront jamais s’il n’y a plus de désir de collaborer.

*Lire aussi notre article : “Comment cultiver la coopération en entreprise ? Faites le plein d’inspirations.”
Ils nous rappellent aussi que le conflit n’est pas toujours ce qui fait mal. Le plus destructeur, parfois, c’est l’indifférence, la résignation, l’abandon de la relation.
Mais ils nous montrent aussi qu’il suffit parfois d’un petit pas, d’un petit écho, d’un petit mouvement pour que quelque chose se réenclenche.
C’est là que notre métier prend tout son sens : non pas faire à leur place, mais leur offrir les conditions pour se retrouver.
Il est temps, peut-être, de sortir de l’idée que le conflit est toujours un problème, et que son absence est toujours une bonne nouvelle. Il est temps de s’intéresser à ces silences prolongés, à ces équipes qui “tournent” mais ne vibrent plus. Car ce sont là que se nichent les vraies pertes d’énergie. Et ce sont là que peuvent aussi naître les plus belles réparations.

Damien Gauthier – Directeur associé et consultant
Pour rester informé-e sur nos thématiques managériales,
abonnez-vous à notre newsletter




